Être un musée vivant, tel est un des objectifs du PHONO Museum Paris. Mais un musée vivant, qu’est-ce-que cela veut dire ? Beaucoup de choses dans la gestion du fonds du musée, bien sûr, mais au delà, permettre aux visiteurs autre chose que de regarder un objet derrière une vitrine. Au musée, on peut faire fonctionner les machines parlantes. Car toutes ou presque sont en état de marche.
Et les faire fonctionner, pourquoi ? Pour que les visiteurs retrouvent le son du passé, entendent comment nos ancêtres écoutaient de la musique. Mais on peut aussi faire autre chose.
Stéphane Catalano est chef d’orchestre et directeur musical de l’orchestre Musica Sconosciuta. D’origine austro-sicilienne, il vit aujourd’hui en France. Il est venu visiter le musée et, en écoutant des disques sur les phonos, lui est venue une idée : réécouter des disques anciens sur des machines de la même époque. Nous avons organisé une conférence avec auditions le 10 mars 2019 avec des disques et des cylindres choisis dans le fonds du musée, des enregistrements de chants, Stéphane Catalano étant spécialiste du lyrique, il a aussi sélectionné les machines pour les écouter. La période choisie pour les enregistrements va de 1900 à 1930. Une expérience passionnante, vivante, humaine, artistique et aussi technique.
Présentons les quatre phonos retenus pour cette conférence. Ils ont été sélectionnés minutieusement par Stéphane Catalano et Jalal Aro, conservateur du musée.


De gauche à droite nous avons :
Le Fontanophone : de 1909 et d’origine française, cet appareil à double bras de lecture de disques et donc à double pavillons très colorés permettait d’avoir un volume suffisant pour les salles de danse. Son usage était donc public. On y écoute des disques à gravure verticale avec un saphir et une vitesse de rotation variant de 80 à 130 tours par minute.
Le Victor School : de 1912 et d’origine américaine était un appareil pour lecture de disques à gravure latérale à fins pédagogiques. La pointe de lecture est en acier et à usage unique si on ne veut pas abimer le disque. Son utilisation était donc publique (écoles) et son pavillon en bois tout à fait remarquable.
Le Pathé S : de 1908 et d’origine française, la vitesse de rotation des disques est de 60 à 100 tours par minute. Il avait vocation à être plutôt utilisé dans des endroits avec du public.
Le Pathé Céleste : de 1900 et d’origine française, cet appareil à cylindres avec une vitesse de rotation de 140 à 160 tours par minute, fut le premier conçu pour synchroniser son et image au cinéma. Notez le pavillon en cristal.
Voilà les appareils sur lesquels les disques et cylindres choisis ont été joués.
Le texte de la conférence donnée par Stéphane Catalano est ci-dessous mais vous pouvez le télécharger sous format PDF.
Débuts à l’opéra 1897, l’Opéra-Comique s’empare de lui 1898; il y reste 22 ans, son plus grand succès est Werther 1903, rôle dans lequel il est considéré comme idéal. Il enregistre la première intégrale de Faust en 1912. Voix puissante, qui avec Edmond Clément, représente un style plus nuancé qui allait se distinguer de l’école italienne.

Mignon – Elle ne le croyait pas – 1903
Mais commençons avec la « vielle école » et
Félia Litvinne, née Schütz en 1860.
D’origine russo-germanique et franco-canadienne, dernière élève de Pauline Viardot, elle a genre de voix « à la Malibran ou Falcon » dans cette lignée très rare, avec des graves puissants et une couleur riche dans le médium qui permettait des rôles de contralto – pourtant elle chantait facilement jusqu’au contre-ut et vocalisait aisément dans les hauts-registres – ses plus grands succès ont été dans des rôles sopranes wagnériens, mais elle restait un modèle de Marguerite dans Faust. Germaine Lubin disait d’elle « elle possédait la flamme », ce qu’on comprend en lisant qu’à partir de 1904 on l’estimait la meilleure Alceste de l’histoire du lyrique, une apparence pratiquement mystique. Peu de ses disques ont pu le capter, mais un cylindre du récitatif et « Air des Bijoux » jamais disponible témoigne bien de son art, sûrement connu par Gounod même, grâce à Pauline Viardot. Egalement valable, et pour vous montrer en revanche l’étendue de cette voix dramatique, je vous ai choisi du Cid de Massenet, « Pleurez mes Yeux », 1908

Le Cid de Massenet – « Pleurez mes Yeux », 1908
Nellie Melba, née Helen Armstrong en 1861.
Elle a une voix de l’âge victorien plus qu’une expressivité moderne. Melba maîtrisait avec une volonté de fer sa technique vocale et sa carrière. Dure, même antipathique avec ses collègues, elle refusa de saluer le ténor John McCormack après « La Bohème », jugeant son niveau inférieur au sien. A sa décharge, peut-on dire que son succès finalement phénoménal passait par maints échecs et déceptions, Paris étant une des première villes qui lui souriait. Malheureusement elle a fait détruire tous ses premiers cylindres de 1895, pourtant on a des disques londoniens de 1904, qui donnent une idée de la force de sa personnalité et un superbe sens du style archaïque à l’anglaise, parfait pour Händel (notez-bien le trille d’un ton changé parfaitement en demi-ton – plus personne ne possède cette technique). Elève de Marchesi, la maîtrise du souffle trouve sa base dans la maîtrise de la ligne par les coloratures, plus que dans une recherche de rapport souffle – ouverture/fermeture lente ou la « messa di voce », plus évident avec Félia Litvinne. Le résultat est néanmoins spectaculaire, cette école fait référence pour des chanteuses telles que Sembrich, Tetrazzini et Calvé. J’ai choisi « Sweet Bird » 1904.
Ceux et celles qui n’adhéraient pas exclusivement à ces écoles mais, comme Léon Beyle, cherchaient une nouvelle vérité vocale toujours sur la base belcantiste commençaient à se manifester de plus en plus. Tant qu’Emma Calvé assimilait la leçon de Mathilde Marchesi, lui permettant de chanter les envols d’Ophélie dans Hamlet ainsi que de se façonner la dite meilleure interprétation de Carmen de tous les temps – rôle qu’elle chantera plus de mille fois et que tristement aucun de ses disques ne réussissent à projeter – Mary Garden refusera après quelques cours l’enseignement d’une autre époque, écrivant dans ses mémoires, « l’idée que Marchesi fasse de moi une machine à coloratures m’était insupportable ! » Cela n’empêcha qu’elle admirait beaucoup Nellie Melba. Toutefois cette première Mélisande allait rentrer dans l’histoire du lyrique en tant que actrice lyrique ou « bombe de scène », comme quelques années plus tard Maria Jeritza à Vienne (la première Ariadne et Femme sans Ombre). Malheureusement Garden détestait tous ses disques à peu d’exceptions, d’où mon dilemme à trouver une chanteuse de cette époque transitionnelle qui nous a laissé des documents sonores représentatifs …
et voilà que je tombe sur Marie Delna. Orpheline abandonnée en 1875, elle reçoit l’enseignement du chant de sa grand-mère, et à l’âge de 17 ans, se fait repérer par Léon Carvalho, directeur de l’Opéra-Comique, où la Parisienne débute avec Didon dans les Troyens de Berlioz; un an plus tard, Massenet la choisit pour créer Charlotte dans Werther, elle n’a que 18 ans. Elle n’abuse jamais de son instrument et chante avec succès dans le monde entier. Tandis que dans certains rôles son abord s’appuie sur des conventions du passé, elle commence à briser le cadre avec Carmen en 1901, rôle qu’elle chantera 800 fois, juste derrière Emma Calvé, et avec aplomb dans un rôle qu’elle créa encore, La Vivandière de Godard
On entend les deux qui datent de 1903/04 « Séguedille » et « Viens avec nous petit »
Mais revenons aux hommes, et surtout la catégorie plus délicate, les ténors …
Francesco Tamagno , né en 1850, la voix qui « faisait trembler le lustre de La Scala ». Il a été considéré comme le plus plus grand ténor verdien du 19ème siècle et créa Othello en 1887, rôle qu’il chanta dans le monde entier. La robustesse de sa voix pousse vers ses limites l’idée d’une vocalisme poitrinée pleine voix qui se sert de chaque résonateur du crâne disponible. Depuis que Gilbert Duprez a émis le premier contre-Ut de poitrine en 1831, son jugé d’une laideur totale par Rossini, il y avait toujours et même jusqu’au début du 20ème siècle des ténors qui continuaient à mixer le falsetto au-dessus du passage, ça veut dire à partir du sol jusqu’à si, ut et plus loin, mais Tamagno représentait un modèle du chant « pleine voix » avec un maximum de mordant, ou « squillo », chose qui rendait le contre-ut possible mais très difficile. Bien sûr il chantait « Di quella pira » dans la transposition traditionnelle de Si majeur.

Di quella pira – 1904

Niun mi tema – Morte d’Otello 1904
Auguste Affre, né 1858 à Saint-Chinian, était appelé le « Tamagno français » et représente justement l’équivalent en utilisant la morphologie, voir la technique typiquement française. Tandis que la voix italienne, comme langue maternelle, fait appel à l’ouverture de l’oxypute pour renforcer la voyelle, la voix française concentre toute sa puissance dans le masque, sollicitant de manière plus limitée le crâne, permettant à la voix de monter, mais souvent sans l’ampleur associée aux voix italiennes. Nellie Melba fera ses débuts à Paris en Lucia avec Affre, et son extrait de la Favorite témoigne de la beauté de son instrument qui toutefois ne craint rien devant un contre ut plaqué devant et devrait rappeler celui de Duprez.

Ange si pur – Favorite, 1911 avec orchestre (je préfère 1904 avec piano !)
Albert Vaguet , qui naît à Elbeuf en 1865 et chante à l’Opéra Garnier pendant 13 ans est en quelque sorte le pendant de Léon Beyle à l’Opéra-Comique, des ténors à la base lyriques mais avec un socle technique solide leur permettant la prise des rôles normalement considéré trop costauds pour leur capacité vocale (ce qui fait justement penser à notre cher Roberto Alagna). Tandis que Tamagno et Affre restaient dans l’exploit et la puissance vocale, Vaguet cherche des effets de mixage pour souligner les textes et n’hésite pas à timbrer la voix. Il débute en 1890 avec Faust, rôle qu’il chante 300 fois à Garnier, passant par des rôles belcantistes héroïques aux grandes parties wagnériennes. Son départ en claquant la porte de l’opéra en 1903 reste un mystère, mais remonte éventuellement au stress dû à l’alternance incessante de rôles trop divers. Toutefois il continue à enregistrer pour Pathé jusqu’à en 1918. Comme on estimait Léon Beyle LE Werther idéal et Albert Vaguet LE Faust idéal, il me semble juste, puisque Beyle a eu les honneurs en premier Faust sur disque, de laisser M. Vaguet prendre sa revanche avec :
Pourquoi me réveiller de Werther, 1909 (Notez-bien l’absence absolue d’agiustamento pour les aigus – « ReveilléEEEEEEEEEEEE!)

Le cylindre Pathé avec sa boîte
Sur la première vidéo, vous verrez comment on ajuste la vitesse de rotation du cylindre pour avoir le bon tempo. La seconde donne l’audition au bon rythme.
Enrico Caruso, né 1873 et mort 48 ans plus tard à Naples, est probablement le ténor qui a su par ses moyens exceptionnels de quelle manière mieux équilibrer les registres et leur puissance sans sacrifier la rondeur et douceur du son, bouclant une symbiose qui fera date. Malgré sa réputation initiale de « ténor de verre » (des canards dans les aigus), il s’est vite fait remarquer en Italie, et suite à la création de Fédora à La Scala sous la direction du compositeur Giordano, il est assailli de propositions. En 1900 Puccini l’entend et s’exclame que Dieu lui a envoyé le jeune ténor. Il transpose l’air de Rodolfo pour Caruso, qui n’arrivait pas à tenir un contre-ut, afin qu’il chante le premier La Bohème à La Scala, dirigé comme pour la création mondiale à Turin par Arturo Toscanini. C’est à cette époque que Tamagno lui même prédit que Caruso sera le plus grand du 20ème siècle. Fasciné par l’enregistrement de la voix, il va étudier comment placer le corps et changer la position de la tête selon le registre pour se faire mieux capter par le pavillon; suite à ses débuts spectaculaires au Met à NewYork en 1903, il signera avec Victor pour faire plus que 450 disques, dont le succès sera planétaire et servira à démocratiser l’opéra pour tous ceux qui n’y avaient pas accès. Son enregistrement de 1907 de « Vesti la giubba » sera le premier disque à se vendre à un million d’exemplaires.

De 4 ans plus tard écoutons un autre des 4 best-sellers de Caruso (les 2 restant étant M’appari et Ombra mai fu) – Celeste Aïda.
Après Caruso, on ne peut que descendre, donc descendons.
Francisque Delmas, notre premier baryton, ou baryton-basse, a délaissé une carrière internationale pour rester fidèle au Palais Garnier où, pendant 42 ans, il chantera plus de 60 rôles, y compris des créations mondiales, la plus importante étant Thaïs avec Sybil Sanderson en 1894.
Né à Lyon en 1861, il fait ses débuts suite à ses études dans le rôle de basse Saint Bris des Huguenots de Meyerbeer en 1886. En écoutant sa Bénédiction des poignards, enregistré pour Pathé en 1904, on a du mal à imaginer la voix monter aux sommets d’extase d’un Athanaël, mais c’était justement ce fond allié à une technique parfaite qui ont permis à Delmas une extension vocale impressionnante. Il reste un des chanteurs les plus appréciés de l’histoire lyrique française.

Meyerbeer – Les Hugenots – Bénédiction des poignards – 1904
Avec Titta Ruffo, né 1877 à Pise, on passe de l’élégance française à une force de nature. Connu en tant que « La voix du Léon », ses premiers professeurs affirmait qu’il n’avait ni voix, ni talent musical — il a suivi l’instruction de son frère jusqu’à ses débuts prudents à Rome. Son succès à partir de 1900 est phénoménal. Bien que moderne dans son objectif d’atteindre l’équilibre parfait entre exploit vocal et subtilité de phrasé, la personnalité rugueuse de Ruffo l’amène à pousser vers l’extrême. Admiré par ses collègues, y compris Caruso et premier Iago Victor Maurel, le grand Giuseppe de Luca disait de lui : « Ce qu’il avait n’était pas une voix, c’était un miracle », rajoutant après « qu’il a détruit finalement en gueulant trop ! ».
En tout cas il a eu au moins 20 ans d’une santé vocale insolente, nettement plus que la plupart des chanteurs d’aujourd’hui.

Pour témoigner écoutons son Credo d’Iago de 1914.
Après Ruffo il faut descendre encore; allez, descendons dans la cave avec une des plus grandes basses françaises de tous les temps,
Paul Aumonier. Né à Paris 1872, il ne voulait pas devenir chanteur : sa voix en a décidé autrement. Fraichement sorti du conservatoire il fait ses premiers disques pour Pathé à l’âge de 25 ans, puis entame ses premiers contrats. Il rentre à l’opéra en 1914. Il avait parmi les plus beaux graves naturels « comme une flèche » de toutes les basses, comme temoigne son « Pif paf » des Huguenots avec ses Fas graves.
Pour finir l’ère acoustique on écoute quelques enregistrements d’ensemble clé, car déjà seul c’était compliqué de bien enregistrer, à deux ou plusieurs, ça frôlait des actes acrobatiques.
Melba/Caruso – O soave fanciulla 1907 : c’est le seul enregistrement des deux monstres sacrés ensemble. Melba admirait la voix de Caruso mais trouvait son comportement vulgaire; ceci n’a pas empêché qu’elle s’est laissée guider par lui afin que sa voix ne se déforme pas devant le pavillon et c’est un document rare dans lequel on aperçoit le vibrato délicat et régulier de l’australienne. Contre le timbre charnu et persuasif du ténor, elle devient plus expressive. Puccini aimait tant la Mimi de Melba qu’il lui a demandé de chanter Butterfly; après quelques semaines avec la partition, elle devait déclarer forfait, toujours consciente des limites de sa voix, trop lourde pour elle. Concernant le contre ut de Melba à la fin, Mary Garden décrit l’expérience en salle dans ses mémoires : « C’était comme une étoile filante : on ne savait pas d’où il venait, mais il passait au-dessus de nos têtes vers l’infini… »

En 1917 Amelita Galli-Curci, Marcel Journet, Giuseppe di Luca, Enrico Caruso, Louise Egener et Antonio Bada se sont retrouvés dans le New Jersey pour enregistrer des ensembles y compris le célébrissime sextuor de Lucia « Chi mi frena in tal momento« . Caruso l’avait déjà mis sur disque à deux reprises, avec Sembrich et Tetrazzini, mais l’interaction chimique entre ses six chanteurs ce jour là, le 25 janvier, pendant qu’une guerre apocalyptique ravageait leurs patries, et peut-être à cause de cela, en utilisant la seule défense contre la bêtise humaine, la culture, ils ont réussi un exploit d’élan expressif sans jamais pour autant sacrifier une structure homogène complètement transparente. Galli-Curci avait chanté Lucia juste deux fois avec Caruso à Buenos-Aires en 1907, sinon ils n’ont jamais chanté ensemble, aussi à cause des efforts de Nellie Melba pour l’écarter de chaque scène où elle régnait incontestée. En Galli-Curci, né à Milan en 1883 et complètement autodidacte, Melba a reconnu une rivale d’une école qui n’avait rien à voir avec les repères qu’elle a connus. Galli-Curci, malgré une maladie qui coupa court sa carrière, allait par son pathos et sa palette de couleurs liée à une technique époustouflante, marquer sa génération de la même manière que Caruso.

Antonio Scotti/Enrico Caruso – « Solenne in quest’ora » 1906
Né à Naples en 1866, Antonio Scotti fait ses débuts à La Scala en 1898 et déjà un an plus tard au Met à New York en Don Giovanni de Mozart où il est vite devenu une vedette de par l’élégance et la force de ses interprétations. Ami proche de Caruso, les deux chantent souvent ensemble dès un premier Rigoletto, débuts du ténor, en 1903, et se ressemblent même vocalement, d’où ce témoignage émouvant : difficile à distinguer au début qui est qui. Après 34 ans de carrière entre New York, Londres, Milan et Paris (en particulier la tournée spectaculaire du Met au Théâtre du Châtelet en 1910), Scotti décide de passer ses dernières années à Naples, où malheureusement son ami déjà parti, il meurt seul dans une pauvreté abjecte en 1936. Il n’y a que quatre personnes qui accompagnent son cercueil.
Passons alors à quelque chose de drôle pour la dernière partie. En 1922 l’enregistrement électrique voit le jour. On n’a pas chômé à capter des voix fraîches, mais étant donnée la nouvelle marge sonore, maints chanteurs qui avaient déjà enregistré de façon acoustique optèrent pour refaire des titres, comme notamment le ténor Beniamino Gigli.
Gabrielle Ritter-Ciampi née à Paris en 1886 ; son père italien, le chanteur Enzo Ciampi, avait tourné avec Adelina Patti. Faisant ses débuts en 1917 avec Traviata, elle devient vite célèbre en France pour des rôles mozartiens qu’elle chante aussi à Salzbourg. Possédant une voix limpide, elle sera la dernière chanteuse à oser le rôle titre dans Esclarmonde de Massenet avec son sol suraigu en option dite « de la tour Eiffel » en 1931-34 avant la reprise célèbre de Joan Sutherland 40 ans plus tard (qui ne chante pas le sol). Souvent comparée à Patti par sa pureté de timbre, elle chante ici de Manon la scène, Cours la reine – 1925

En 1929 la jeune draguignanaise Alice-Joséphine Pons se fait rejeter par l’Opéra de Paris après avoir débuté à Mulhouse dans Lakmé et chanté avec succès dans toute la France. Tentant sa chance à New York, le grand ténor Giovanni Zenatello la recommande au directeur du Met, Giulio Gatti-Casazza, et en javier 1931 elle fait des débuts fracassants à New York en Lucia avec Gigli et Pinza. Les Américains ne lâchent plus de la « Frenchie », elle y restera 28 ans, fera même des films à Hollywood. Le ténor Giacomo Lauri-Volpi écrivait d’elle que jamais il n’a connu une voix aussi fine d’une aussi longue étendue qui portait dans une grande salle. Même Gatti-Casazza écrit dans ses mémoires qu’avec « le déclin vocal évident de nos jours, il y a toujours des chanteurs comme Ponselle, Gigli, Pinza et Pons qui arrivent à porter le flambeau », pas un mince compliment. Son enregistrement de l’air des clochettes de 1930 reste une référence, malgré quelques petits manques d’articulation qu’elle va vite corriger – à entendre dans un film de 1936. Ses efforts appuyés à chanter pour les troupes alliées au front pendant la Deuxième guerre mondiale seront récompensés : elle triomphe à Paris en 1945 dans Lakmé et à la demande de la Ville de Paris chante la Marseillaise sur le balcon du Palais Garnier devant 250 000 personnes le 8 mai pour la Libération.
Gabrielle Ritter-Ciampi Manon la scène, Cours la reine – 1925 puis Lily Pons – Air des Clochettes – 1930
Du rayonnement français des deux côtés de l’Atlantique, on tourne vers probablement la dernière voix de l’époque dite de « l’âge d’or ».
Rosa Ponselle, née Rosa Ponzillo de parents italiens dans le Connecticut en 1897, commence sa carrière en tant que pianiste accompagnatrice des films muets puis s’amuse à chanter des duos avec sa soeur Carmela dans des théâtres du vaudeville. Sa voix est tellement hors norme sans enseignement vocal que l’agent de Carmela demande à Caruso de venir l’auditionner. Caruso, profondément ému par sa voix la recommande à l’impressario du Met, et quelques jours après la fin de la Grande guerre, avec uniquement la préparation du coach Romano Romani, un protégé de Puccini, elle fait ses débuts dans « La Force du Destin » de Verdi avec Caruso : une légende est née. Elle restera fidèle au Met par peur de perdre ses repères et ne chantera que trois saisons à Covent Garden à Londres et une fois à Florence en 1933. Elle travaillera tout le répertoire italien avec Romani, et la consécration de sa carrière sera Norma en 1927, dont avec Maria Callas, elle est considérée comme l’interprète la plus aboutie du siècle. On l’a surnommé « Le Caruso en jupons ». Elle quitte la scène précipitamment en 1937 suite au refus du nouveau directeur de monter Adriana Lecouvreur pour elle, mais elle a du sentir que le monde avait changé. Néanmoins elle entretient sa voix et enregistre même une collection de mélodies dans les années 50 – la voix est toujours sublime. Elle écrit que chaque matin elle allait au piano et s’essayait avec le trille et terminaison en piquées de la cabalette d’Ernani Involami – si cela marchait elle chantait, sinon, elle claquait le couvercle du piano et sortait faire autre chose. Ecoutons cet enregistrement référence.
Ernani Involami – (1923 non édité, extraordinaire, ou 1929, la référence)
Revenons en France pour achever notre cercle de chanteurs modernes de Léon Beyle à
Georges Thill. Parisien de naissance, il devient, jeune, mordu des disques de Caruso et les imite; pourtant son parcours au conservatoire est frustrant et il décide d’aller en Italie étudier avec Fernando de Lucia, grand belcantiste à Naples. Par lui, il trouve un équilibre entre l’émission classique française et une maîtrise de souffle à l’italienne qui lui permet de renforcer son médium et ses graves sans pousser dans le masque. De Lucia lui donne les outils pour faire une vraie symbiose qui, dès son entrée à l’Opéra, fera l’effet d’une bombe : Thill devient le spécialiste incontesté pour le style français du chant. Même si son émission reste devant, bien notée par Lauri-Volpi, son rapport à une voyelle qui reste posée sur le souffle, est pure, sollicitant des résonateurs naturels qui lui offrent une homogénéité, une clarté de diction et une aisance rare.
Avec Thill, l’art du chant français atteint son apogée.
Georges Thill – Salut demeure chaste et pure – 1930
oOo
Alors, soyons honnêtes, nous ne sommes pas les premiers à avoir ce type d’approche. Déjà en 1947, Michel de Bry, membre de l’académie du disque français, avait eu l’idée comme le prouve le document « Michel de Bry, causerie 6 juillet 1947«
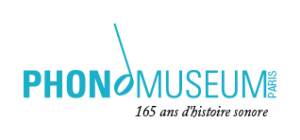



Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!