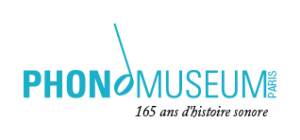L’esthétique du gramophone selon Sascha Brosamer
L’ESTHÉTIQUE DU GRAMOPHONE SELON SASCHA BROSAMER.
Sascha Brosamer, artiste outre-Rhin, est un Ami du PHONO Museum Paris, de longue date. Il est venu à Paris accomplir certaines de ses œuvres artistiques. Sascha Brosamer travaille actuellement à la mise au point d’un pigment noir spécifique, le « Shellac Record Black », créé à partir de disques en gomme-laque originaux de la collection Phonopassion, afin de réaliser une série de peintures inédites, en utilisant ce pigment noir.
La théoricienne de la culture matérielle et sonore Élodie A. Roy retranscrit les motivations profondes de l’Artiste.
L’esthétique du gramophone selon Sascha Brosamer
La fascination de Sascha Brosamer pour le gramophone a débuté il y a près de vingt ans, alors qu’il était étudiant à l’Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe. Mais c’est bien des années plus tard, à Paris, que l’artiste a commencé à saisir plus intensément le potentiel créatif de l’appareil, à la fois comme vecteur sonore et visuel. C’était en 2017. Sascha Brosamer jouait sur un gramophone emprunté dans un appartement haussmannien déserté, dont les propriétaires étaient partis ou décédés. Cette première performance (non documentée) s’intitulait « Jacqueline et Pierre ». Déjà, l’artiste se sentait attiré par l’aura de passé qui émanait de l’appareil et par le pouvoir évocateur du son, capable de faire surgir des temps et des lieux disparus (avant de disparaître à son tour). Plus que tout autre médium, le son pouvait raconter une histoire sans en dévoiler l’intrigue : il révélait tout, tout en préservant le mystère. Il pouvait faire apparaître des pièces entières ou faire disparaître des murs. Il se souvenait autant qu’il effaçait. À partir de « Jacqueline et Pierre », les gramophones sont devenus un élément incontournable des œuvres de Sascha Brosamer (servant à la fois de supports visuels et d’instruments centraux dans les concerts).
Bien que Sascha Brosamer ait perçu dès le départ la valeur du gramophone en tant qu’objet historique, et qu’il ait rapidement tissé des liens étroits avec des collectionneurs en Allemagne et à l’étranger, son travail dépasse la simple nostalgie. Les disques en gomme-laque et les appareils de lecture représentent bien plus pour lui que de vieux artefacts prenant la poussière dans des pièces à demi oubliées (à l’instar des aspidistras évoquées par George Orwell). Il les perçoit plutôt comme des objets qui lui permettent de collecter, d’accéder et de libérer l’esprit de notre époque. Ils sont pleinement et intensément vivants, en permanence.
Les gramophones de Sascha Brosamer sont autant de portes d’entrée vers le flux (excessif) de la temporalité elle-même, dans sa dimension dynamique et indéterminée. Il est peut-être logique qu’au fil des ans, il ait joué – et trimballé à travers le monde – d’innombrables gramophones portables. Ce qui le fascine, c’est l’esthétique de la valise que représente la phonographie : pressé sur de la gomme-laque, le son peut être transporté, et il transporte à son tour les auditeurs. Son œuvre a toujours témoigné d’une sensibilité particulière à la dimension mondiale et nomade du son enregistré (y compris son histoire coloniale : symbole de domination impériale autant que moyen d’émancipation et de pouvoir). Cette sensibilité s’exprime, par exemple, dans une installation de 2017 intitulée « La Polyphonie des ports coloniaux », présentant cinq gramophones-valises en équilibre précaire sur des boîtes en verre contenant des plantes vivantes (une œuvre proposée dans un esprit de dialogue avec l’analyse critique de la phonographie mondiale proposée par Michael Denning dans son ouvrage « Noise Uprising », 2015).
Au premier abord, avant même qu’il n’actionne le levier, les gramophones de Brosamer apparaissent comme des ready-mades (dans la lignée de Duchamp). Pourtant, ce sont aussi des appareils sonores : ils ne sont pas choisis pour leur attrait visuel, mais pour les strates de mémoire qu’ils recèlent et qu’ils peuvent exprimer par le son. La démarche de Sascha Brosamer est résolument archéologique, voire phono-archéologique. Il cite les Thèses sur la philosophie de l’histoire de Walter Benjamin (1940) parmi ses influences.
Selon ses propres termes : « Mon attrait pour la gomme-laque, et en particulier pour les pressages de la société Art-Tune de Hong Kong, réside dans leur double nature : ce sont à la fois des objets musicaux et des palimpsestes culturels, chaque disque faisant converger de multiples histoires, qui se transforment à chaque écoute. »
Ainsi, Brosamer utilise-t-il les tourne-disques comme de délicates et imprévisibles machines à remonter le temps, nous permettant de remonter toujours plus loin dans le passé. Une séance d’écoute se transforme rapidement en une sorte de spiritisme. En passant des disques de la première moitié du XXe siècle, l’artiste brouille également les frontières. L’écoute ne nous transporte pas comme par magie dans le passé, et encore moins n’engage-t-elle un dialogue fluide avec les événements historiques. Nous ne pouvons même pas commencer à saisir l’immensité du passé. Nous prenons plutôt conscience de l’irréversibilité de ce qui a été. Et pourtant, le passé ne disparaît pas. Il persiste, il vacille. Il crépite. Il se fige, impuissant. Qu’entendons-nous ? Où nous situons-nous ? Où portons-nous notre attention ? Où se porte notre regard ? Lorsque j’écoute des disques 78 tours, je me surprends à hésiter : je ne sais plus vraiment ce que j’écoute, ce que je cherche à entendre. Le monde entier se met à trembler. Les frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur s’estompent. D’une certaine manière, j’entends les échos de mon propre émerveillement, de ma confusion, de mon propre sentiment de déracinement. Je n’entends pas le passé : j’entends des vagues de passé, certaines infimes, d’autres monumentales, qui s’écrasent sans cesse sur les rivages du présent. J’entends l’ambiguïté, la répétitivité, les cycles du temps et de la mort qui me submergent. L’effet peut être bouleversant, voire déstabilisant, et il crée une énergie brute et rare : les signaux acoustiques se transforment en pure électricité.
Ainsi, à travers ses récitals immersifs sur gramophone, Sascha Brosamer crée un espace d’écoute et de réflexion, un lieu où se déconnecter temporairement de notre environnement immédiat (afin de mieux percevoir notre situation actuelle sous un autre angle). Son œuvre révèle la vitalité excessive, presque hallucinatoire, et la postérité des objets culturels. Ces dernières années, il a fusionné des technologies d’écoute archaïques et hyper-contemporaines, combinant des disques découpés à la main, inspirés par Christian Marclay, avec des performances participatives sur smartphone utilisant la technologie Grainfield de l’IRCAM pour créer des espaces d’écoute immersifs.
Je crois qu’il s’intéresse autant au son enregistré qu’aux espaces non marqués et non enregistrés (pourtant jamais silencieux) entre les sillons – à ces bruits aléatoires et parasites qui sont aussi des moments où la vie et le sens peuvent renaître.
Malgré leur immatérialité, les fantômes ont besoin d’environnements physiques pour exister. Ils hantent les maisons, les objets du quotidien – les textures familières. Surtout, comme Derrida et Stiegler l’ont souligné lors de leurs échanges sur les spectres audiovisuels, ils sont dépendants de la technologie, chaque nouvelle technologie engendrant des modes et des formes de hantise particuliers.
Affirmer que Sascha Brosamer travaille avec les fantômes signifie donc aussi que son œuvre prend pour point de départ – et reconnaît – le substrat matériel du monde (dans la tradition ludique de Fluxus et de Joseph Beuys, l’une de ses principales influences). L’art de Sascha Brosamer intègre la matière de l’expérience quotidienne, le fragile socle commun de l’histoire – ainsi que les tentatives de donner un sens à cette histoire – avant qu’elle ne se désagrège à nouveau.
Elodie A. Roy
Sascha Brosamer’s Gramophone Aesthetics (Original Text)
Sascha Brosamer’s fascination with the gramophone began nearly two decades ago when he was a student at the Karlsruhe Academy of Fine Arts. But it is years later, in Paris, that the artist started grasping more acutely the machine’s creative potentials – both as a sonic and visual vessel. The year was 2017. Brosamer played a borrowed gramophone in a deserted Haussmannian apartment whose owners had left, or passed away. This early (undocumented) gramophone performance was called Jacqueline et Pierre. Already the artist felt drawn to the device’s aura of pastness – and to the evocative power of sound to conjure up vanished times and places (before vanishing in turn). More than any other medium, sound could tell a story without giving any of the plot away – it revealed everything while keeping the mystery intact. It could conjure up entire rooms, or make walls disappear. It remembered as much as it erased. From Jacqueline et Pierre onwards, gramophones became a fixture of Brosamer’s works (both serving as visual prompts and as central instruments in concerts).
Although Brosamer perceived from the start the gramophone’s value as an historical object, soon forming very close acquaintances with collectors in Germany and beyond, his work goes beyond nostalgic attachment. Shellac records and playback devices are much more to him than retro artefacts quietly gathering dust in semi-forgotten rooms (like George Orwell’s proverbial aspidistra plants). Rather, he sees them as objects that may help him collect, and access/liberate, the spirit of the present era. They are completely, vibrantly alive – at all times.
Brosamer’s gramophones act as gateways into the (over)flow of temporality itself – in its dynamic, indeterminate quality. Perhaps it is fitting that over the years he should have played – and lugged around the world – countless portable gramophones. What appeals to him is phonography’s suitcase aesthetics: pressed onto shellac, sound can be transported, and it transports listeners in turn. His work has always showcased a particular sensitivity to the global, nomadic dimension of recorded sound (including its colonial history: as a symbol of imperial domination as well as a means of potential empowerment and emancipation). This sensitivity is expressed, for instance, in a 2017 installation entitled The Polyphony of the Colonial Ports, showing five suitcase gramophones precariously perched onto glass boxes containing living plants (a work offered in a spirit of dialogue with Michael Denning’s critical reading of global phonography in his book Noise Uprising, 2015).
At first sight, and before he starts cranking the lever, Brosamer’s gramophones exist as readymades (in the tradition of Duchamp). Yet they are also sounding devices : they are not chosen for their visual appeal – but for the layers of memory they hold and may sonically express. Brosamer’s approach is resolutely archaeological – or, perhaps, phono-archaeological. He cites Walter Benjamin’s 1940 Theses on the Philosophy of History as one of his influences.
In his words, My attraction to shellac, particularly Hong Kong’s Art-Tune Company pressings, lies in their dual nature: they are both musical objects and cultural palimpsests [with] each record bring[ing] multiple histories into alignment, changing with each encounter.
Accordingly, Brosamer uses record players as delicate, unpredictable time machines, as means of going further and further back in time. A gramophone listening session quickly becomes a séance with ghosts. As he plays records from the first half of the century, the artist also blurs boundaries. When we listen, we don’t magically return to the past – let alone enter into a seamless conversation with historical events. We cannot even begin to measure the vastness of what has gone. Rather, we become aware of the irreversibility of what has been. And yet the past doesn’t vanish. It lingers and it stutters. It crackles. It gets stuck – helplessly. What do we hear? Where do we place ourselves? Where do we direct our ears? Where does our focus lie ? When I listen to 78s records I suddenly hesitate: I’m not sure anymore what it is I am listening – what I am listening for. The whole world begins to shake. Frontiers between the inner and the outer realms get blurred. In some ways, I hear reverberations of my own wonder, my confusion – my own sense of displacement. I’m not hearing the past: I’m hearing waves of pastness, some tiny, others monumental, endlessly crashing to the shores of the present. I’m hearing ambiguity, repetitiveness, the cycles of time and death washing over me. The effect can be overwhelming or destabilizing – and it creates a rare, raw energy – acoustic signals become pure electricity.
And so, with his immersive gramophone recitals, Brosamer creates room to listen, to reflect – a space to become temporarily estranged or de-tuned from our immediate environment (so as to better perceive our current situation, from another angle). His work reveals the excessive, hallucinatory vitality – and afterlife – of cultural commodities. In recent years, he’s brought together archaic and hyper-contemporary technologies of listening, combining “handmade cut-up records inspired by Christian Marclay with participatory smartphone performances that use IRCAM’s Grainfield technology to create immersive listening spaces.”
I believe he’s as interested in recorded sound as he is in the unmarked and unrecorded (yet never silent) spaces between the grooves – in the random, parasitic noises that are also moments where life and meaning may emerge anew.
For all their immateriality, ghost need physical environments to exist. They dwell in houses, domestic objects – familiar textures. Importantly, as Derrida and Stiegler once noted in their conversations on audiovisual spectres, they are technology-dependent, with every new technology giving rise to particular modes and forms of haunting.
To say that Brosamer works with ghosts therefore also means that his work begins with – and acknowledges – the material substrate of the world (in the playful tradition of Fluxus and Joseph Beuys, one of his key influences). Brosamer’s art incorporates the stuff of everyday experience, the fragile, common ground of history – as well as the attempts to make sense of that history – before it starts falling apart again.
Elodie A. Roy